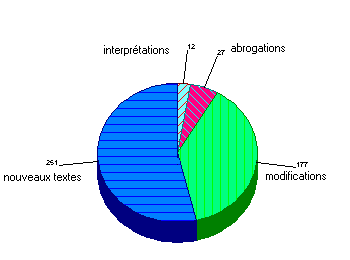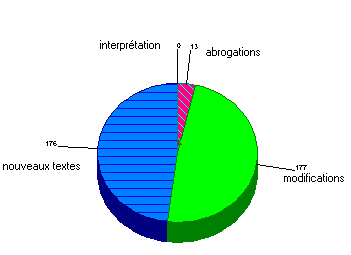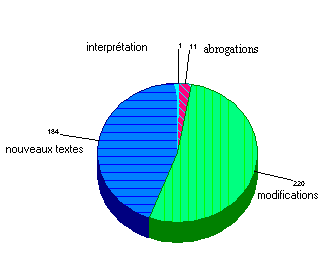|
STRATEGIE
COLONIALE ET ORGANISATION DE LA JUSTICE SOUS LA IIIeme REPUBLIQUE
|
|
LES TEXTES DE LA STRATEGIE COLONIALE EN
MATIERE D'ORGANISATION JUDICIAIRE
|
OBJET
DES TEXTES RELATIFS A L'ORGANISATION JUDICIAIRE
Chacune des normes étudiées
a été édictée soit dans le but de créer
un droit nouveau , soit pour modifier un texte existant, soit pour le supprimer
ou pour l’interpréter.
La
proportion entre textes nouveaux et modifications a subi des variations
tout à fait logiques. En effet, de 1897 à 1913, les textes
nouveaux constituent plus de la moitié de l’effectif (54%), cela
peut s’expliquer par le fait que, pour certaines colonies, toute la structure
judiciaire est à mettre en place ; de 1914 à 1926, les créations
de normes et les modifications occupent exactement la même place
(48% chacune) ; sur la dernière période, les modifications
ont pris le pas sur les textes nouveaux (52%). La structure judiciaire
est alors en place, les grands ensemble coloniaux fonctionnent bien, il
s’agit donc d’aménager, d’améliorer, d’ajuster et moins de
créer.
Les
grahiques suivants illustrent ce propos.
OBJET DES TEXTES DE 1897 A 1913
Les normes sont principalement
créatrices de nouveaux droits, en matière de justice puisque
53,7% des textes sont des textes nouveaux. On note cependant un réel
effort d’adaptation puisque, tout de même, 37,9% d’entre eux ont
pour objet des modifications de règles existantes.
|
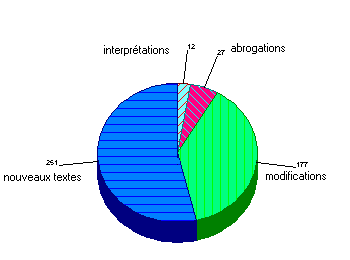 |
OBJET DES TEXTES DE 1914 A 1926
La majorité des textes
se partagent à parts égales entre les textes nouveaux et
les modifications avec respectivement 48%, ce qui constitue une évolution
par rapport à la période précédente où
les textes nouveaux dominaient largement. En outre on dénote un
affaiblissement des abrogations avec seulement 13 abrogations.
|
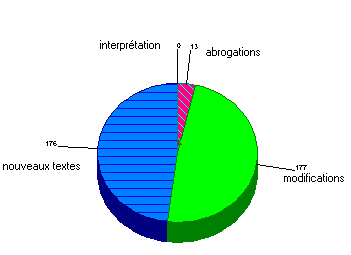 |
OBJET DES TEXTES DE 1927 A 1939
| On note une très
nette évolution par rapport aux périodes antérieures
car les modifications de textes sont largement dominantes. Ce phénomène
est compréhensible puisque, durant la période de 1927 à
1939, la plupart des pays colonisés ont un système judiciaire
déjà mis en place, il est donc normal que les aménagements
de ce système soient majoritaires. |
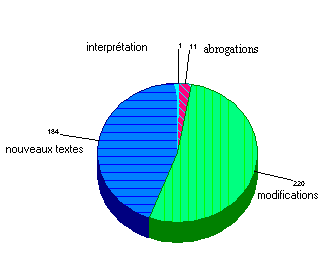 |
Revenir à l'accueil
Poursuivre en étudiant la portée
des textes